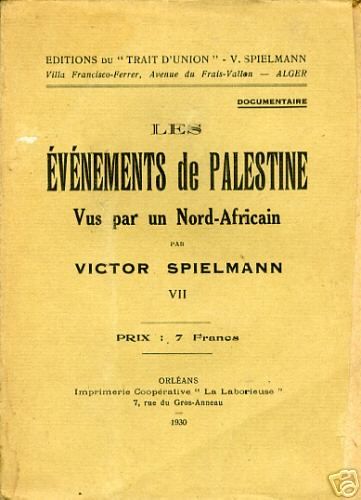Même si le communisme est une idée récente, elle était vivante dans les luttes des humbles. Sa présence jalonne l'Histoire de l'Humanité. Depuis la nuit des temps les combats contre les inégalités existaient. La doctrine qui est venue leur donner des livres pour identifier et rassembler une même philosophie en théorie...
D'emblée il est nécessaire de situer que le contexte qu'offrait Bordj-Bou-Arréridj pour que se tienne une résistance à l'occupant français est assez particulier. L'actuelle agglomération urbaine n'existait pas, avant 1870, date de la révolte d'El-Mokrani. Seul l'édifice des janissaires, communément appelé "Château" actuellement, était construit et tenu par une faction d'une cinquantaine d'hommes. Autour duquel des autochtones avaient élu sédentarisation dans quelques gourbis. Ils vivotaient de travaux que leur permettait lors du paiement du dû en contrepartie du protectorat ottoman pour l'ensemble du pays. Le vrai travail à cette époque était agricole. Et ne manquait pas les terres fertiles, citées par le chanteur Rabah Driassa "El-Bordj" Essaba. Et Avant lui le chantre de la chanson chaoui, Aïssa El-Djarmouni, disait "El-Bordj Al-Aâli" (Bordj le haut).
Puis la conquête française est venue, arrivant vers 1840 dans la région. En préparation du passage de voie ferrée, utile à l'empire colonial pour extraire les richesses, une bourgade est née et deviendra attrayante. Le tunnel d'El-Achir a été percé dans la montagne de Aïn-Defla en 1870, comme témoigne un écriteau gravé sur la roche à son entrée en venant de l'ouest.
Alors que les hostilités contre les partisans de la colonisation prenaient de l'ampleur chez les berbères et la tribu des H'chems, Bordj abrita des colons, chrétiens, juifs et Algériens. Tous ces derniers constataient que le nouvel occupant français ramenait un mode vie différent. Le changement les intéressait parce que les gardiens des frontières, les turcs ne permettaient rien, afin de se défendre des pénétrations des croisades constamment menaçantes...
Alors que les Ottomans interdisaient les contacts de la population, avec l'extérieur et appliquait la barbarie de la charia islamique, cette autarcie n'avait apporté aucun progrès. Ce qui a laissé, des siècles durant, la nation dans l'arriération. En effet c'est la gouvernance turque qui empêchait l'envahissement des croisades européennes, qui n'avait rien développé, y compris dans son propre fief aux portes de l'Asie dont Constantinople et Istanbul.
Avec le train passant à Bordj, sa gare se situe en équidistance entre Alger et Constantine, presque égale entre Sétif et Bouira ou bien M'Sila et Béjaïa. Elle s'y prête à la gestion des vacations du personnel des cheminots et en relai régional important, avec une position géographique idoine à la nouvelle d'économie venue avec la présence française violente et spoliatrice des terres.
C'est avec le rail que Victor Speilmann s'est trouvé, en 1977, à Bordj dès 11 ans de son âge. Le texte suivant le décrit fidèlement en homme majeur dans le mouvement ouvrier, indigéniste et anticolonial qui n'a jamais cessé d'exister depuis que la soldatesque de la France a débarqué. La résistance n'a pas arrêté mais elle était souvent faible, traquée, persécutée, isolée et désorganisée.L'Emir Khaled, qui a été soutenu par Spielmann
Fils d’un optant alsacien, Victor Spielmann arrive en Algérie en 1877 à l’âge de 11 ans. Son père parvient à obtenir un petit lot de colonisation à Bordj Bou Arreridj. Mais, comme nombre de petits colons, il mène une vie difficile sur une terre ingrate. En 1897, pour son fils qui lui a succédé, c’est la ruine et la saisie de ses biens. Cette expérience éprouvante contribue à faire de lui un révolté. Il va désormais mener une lutte de tous les instants contre « l’Administration », en fait contre ce système colonial dont il allait progressivement percevoir qu’il exploitait et opprimait davantage encore les Algériens de souche. Pour s’assurer le pain, un temps cordonnier, puis représentant de commerce, il se lance aussi dans le journalisme. Toujours sur le qui-vive, il parcourt le bled pour dénoncer sans relâche la grosse colonisation, les banques et les puissants de la bourgeoisie coloniale. Fin xixe-début xxe siècle, particulièrement dans sa région – le Constantinois –, la défense des Européens de basse condition va volontiers de pair avec la dénonciation des Juifs, laquelle sous-tend la crise « autonomiste » créole de 1898 : les ressentiments sociaux sont exploités démagogiquement par un « parti radical antijuif » dont le maire de Constantine Émile Morinaud est le dirigeant le plus en vue. Existait en Europe un antisémitisme populaire, qui fut aussi le fait de nombre de « petits blancs » d’Algérie : dans leur pré-carré dénommé français, ils voyaient dans les petits commerçants et artisans juifs, généralement fort pauvres, des rivaux auxquels le décret Crémieux (1870) avait indûment conféré la nationalité française.
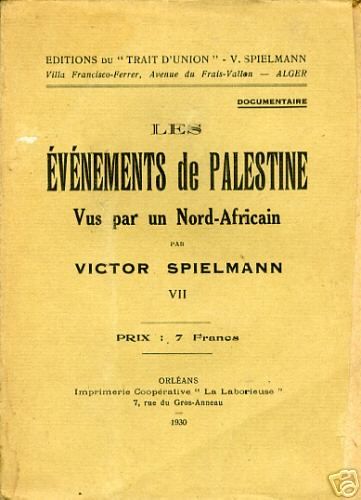
Toutefois, indisposé par la compromission croissante des notables du parti antijuif avec les potentats de la bourgeoisie coloniale, Spielmann rompt en 1902 son compagnonnage politique avec eux. Reprenant sa liberté, il se consacre désormais aux problèmes de sa région. Avec quelques compagnons, il écrit dans de petits journaux locaux – L’Écho d’Aïn Tagrout, Le Cri des Hauts Plateaux, L’Avenir de Bordj Bou Arreridj… –, tout en militant politiquement selon un mode protestataire et en collaborant à de nombreuses œuvres sociales – syndicats agricoles, bibliothèques populaires, sociétés de secours mutuel, orphelinat du peuple…
Dans le même temps, il se lie avec Gaston de Vulpillières, socialiste humaniste, libertaire et internationaliste, archéologue de l’antique Calcaeus Herculis (El Kantara), et défenseur passionné des Algériens misérables du Village rouge d’El Kantara parmi lesquels il vit. Dans son sillage, Spielmann étend de plus en plus ses activités à la défense des Algériens. En 1906, il collabore au journal algérois de Vulpillières, Le Croissant-El Hillal, « organe des revendications indigènes ». Il contribue ainsi à aiguillonner les velléités de réformes entamées par le gouverneur général de l’Algérie Charles Jonnart et à soutenir cette haute figure « indigénophile » que fut le député de la Haute-Marne Albin Rozet. Il dénonce le Code de l’Indigénat de 1887, qui codifie la discrimination ; il dénonce sans relâche les abus de l’administration coloniale, qui moleste colons pauvres et « prolétaires indigènes », pour lui tous victimes d’un même système régi par les gros colons et les banques, en commerce avec quelques bachaghas acquis et intégrés au système. Fin 1910, Spielmann devient le collaborateur de Sadek Denden, à son journal L’Islam, le plus connu des journaux « jeunes-algériens ».
4De 1912 à la guerre de 1914, Spielmann est le correspondant pour l’Ouest Constantinois du Cri de l’Algérie, dirigé par Vulpillières. La grande dénonciation du journal est celle de l’imposition aux Algériens du service militaire obligatoire, institué par le décret du 31 janvier 1912, cela sans compensation aucune – « un scandale ». Il ne réclame pourtant guère, à la différence de ses amis jeunes-algériens, le droit de vote : en société coloniale, il serait pour lui bafoué, et ne servirait qu’à affermir l’emprise d’une « bourgeoisie indigène » qu’il exècre. Aux côtés de son ami Deybach, lui aussi alsacien, Spielmann est présent partout où des incidents entre recruteurs et conscrits se produisent – et ils sont légions. Il témoigne :
« Si nous, Alsaciens, nous plaignons des spoliations et des vexations dont nous sommes victimes de la part de l’Allemagne, que doivent dire les indigènes patriotes de leur Algérie, pour avoir été, sous prétexte d’insurrection, dépouillés de centaines de milliers d’hectares des meilleures terres, sans compter l’amende de guerre. Les Allemands, en 1870, se sont contentés de l’amende et d’une partie de notre territoire. C’est pour cela que je proteste contre toutes les injustices dont on les abreuve. Comment, avec de telles spoliations territoriales, vous trouvez tout naturel qu’on appelle les enfants des Indigènes sous les drapeaux pendant trois ans, au lieu de deux comme les nôtres, et sans compensation d’aucune sorte ? Mets toi à leur place, et, là, dis moi franchement ce que tu ferais de l’arme que ton spoliateur te confierait ? Il faut être insensé pour ne pas voir où nous allons. Si je réclame des compensations, ce n’est pas tant le bulletin de vote que je vise, car nous ne sommes pas mûrs nous-mêmes pour l’employer utilement, mais leur émancipation civile, afin qu’ils échappent à leurs tortionnaires administratifs ».
Spielmann dénonce inlassablement les trafics dont la conscription est l’occasion, qui enrichissent les agents de l’administration et des notables de telles grandes familles algériennes ; et aussi les spoliateurs des fellahs qui s’engraissent de la colonisation foncière, et leurs comparses, administrateurs de communes mixtes et autres « adjoints indigènes ». Le ton du Cri de l’Algérie, violent, amer, souvent désespéré, est plus proche de la dénonciation libertaire que du socialisme marxiste. Les articles, toujours grinçants, jamais drôles, donnent un sombre tableau du Constantinois à la veille de la Première Guerre mondiale.
On perd la trace de Spielmann pendant la guerre, au lendemain de laquelle il se trouve proche des positions des communistes d’Algérie. Il dut un temps adhérer au parti, même s’il resta toujours marginal par rapport à lui, avant de s’en éloigner en 1925, puis de rejoindre formellement la SFIO. Il resta cependant un atypique. Ahmed Khobzi, l’instituteur communiste à qui le liait une solide amitié, disait de lui : « Il était trop rebelle pour accepter la discipline, trop anarchiste pour accepter un maître ». De fait, il avait baptisé le très modeste pavillon où il vivait avec sa femme Hélène Bonino, à Frais Vallon, au flanc de Bab El Oued, « villa Francisco Ferrer », du nom du célèbre militant anarchiste et anticolonialiste catalan, fusillé à Barcelone en 1909.
L’Ikdam et La Lutte sociale étaient imprimés par la même…« Le nationalisme n’est pas le socialisme » ; « les indigènes…Spielmann n’en collabora pas moins dès 1921 à la Lutte sociale, devenue communiste après le congrès de Tours. Si nombreux étaient alors les communistes à n’être pas hostiles « aux aspirations d’indépendance coloniale », d’autres, dans l’inspiration de la motion de la section de Sidi Bel Abbès (1922), continuaient à coups d’arguments foncièrement coloniaux, à s’en tenir à des positions social-colonialistes. Sous l’impulsion du professeur d’histoire André Julien, alors en poste en Algérie, Spielmann allait jouer un grand rôle pour étayer les dossiers tant réclamés par le futur grand historien du Maghreb, connu ultérieurement sous le nom de Charles-André Julien – il était alors communiste –, en vue d’argumenter les positions politiques sur le sujet, crucial, de la colonisation. D’emblée, ses articles s’imposèrent. Malgré – ou grâce à – son style lourd et ses exemples ressassés, Spielmann faisait preuve de pédagogie. Toujours avec des dossiers précis, nourris de chiffres surabondants, il cherchait avec obstination à expliquer comment la France conduisait en Algérie une politique injuste et discriminatoire, affamant les « mesquines » (sic) et les maintenant dans l’ignorance. Notamment, grâce à lui, exista un temps dans ce journal communiste un certain dialogue entre communistes, et aussi entre les communistes et tels porte-parole de l’Algérie algérienne. Le journal de l’Émir Khaled, L’Ikdam – qui avait succédé à L’Islam d’avant guerre –, volontiers brocardé pour sa tiédeur à l’égard de la révolution bolchévique, fut pourtant de plus en plus ménagé grâce à Spielmann : ce dernier était de longue date l’ami de Khaled, et il devint son collaborateur politique ; Spielmann acquit une véritable stature de trait d’union franco-algérien – il donna ce nom de trait d’union à son journal et à la maison d’édition qu’il fonda à cette époque. Ferhat Abbas eut pour lui ces mots :
« Victor Spielmann publiait La Tribune, et ensuite Le Trait d’Union. Ce courageux Alsacien, dont j’évoque avec émotion le souvenir, ancien colon de Bordj Bou Arreridj, prenait violemment à parti les pouvoirs publics, et dénonçait avec vigueur l’expropriation des Arabes et leur ruine. À certains égards, il était un des plus valeureux défenseurs de notre cause ».
Spielmann cessa de collaborer à La Lutte sociale à l’été 1924, probablement au moment où il prit ses distances avec le PC. Mais il consacra l’essentiel de son activité, de 1919 à l’exil de l’émir Khaled, à l’été 1923 – et même au-delà, pendant sa relégation à Alexandrie –, au combat de ce dernier. Un grand nombre de textes en français du petit-fils de l’émir Abd El Kader furent en fait écrits par Spielmann : on retrouve dans la prose en français de Khaled les thèmes, les tics de plume, les textes hachés en paragraphes courts, caractéristiques de son mode d’écriture. Le texte de la conférence faite par Khaled à Paris les 12 et 19 juillet 1924, lors de son bref retour à Paris après la victoire du Cartel des Gauches – la seconde sous les auspices de l’Union intercoloniale communiste – fut publié à Alger à ses éditions du Trait d’Union. Et le texte de cette conférence ressemble fort à la pétition que Khaled avait adressée en avril 1919 au président américain Wilson pour plaider la cause algérienne : l’historien peut penser que, plausiblement, le texte de la pétition fut largement inspiré, sinon rédigé par Spielmann.

Dans l’Ikdam, Spielmann continua à écrire les mêmes articles dénonciateurs dont il était coutumier. À partir de 1922, au moment de la radicalisation de Khaled, l’émir lui donne de plus en plus la parole. Il fut sans doute le plus fidèle de ses fidèles ; il popularisa sa figure de za‘ īm (guide du peuple, leader) algérien équivalent du za‘ īm égyptien Saad Zaghloul. Après son exil, il ne cessa de clamer : « Nous ne cesserons de crier : rendez-nous notre Émir, notre Zaghloul Pacha ! » De son exil oriental, Khaled maintint les liens avec Spielmann. En 1925, il le chargea d’examiner un projet de création à Alger d’un quotidien franco-arabe. Malgré ses efforts pour recueillir des fonds, le journal ne vit jamais le jour. Spielmann ne put que continuer son combat dans son Trait d’Union, fondé après la disparition de L’Ikdam, qui suivit l’élimination politique de Khaled ; mais sans l’émir, et sans non plus le compagnonnage de plume des communistes. Il tenta – mais sans succès – de mettre sur pied un cercle franco-nord-africain, cela sans aucune référence à la république des Soviets. Il publia en 1930 à ses éditions du Trait d’Union le premier livre de Ferhat Abbas, Le Jeune Algérien, qui fut simultanément publié à Paris aux éditions de la Jeune Parque.Dans les articles et les multiples brochures publiés par Spielmann, les républiques soviétiques ne sont jamais citées comme symboles du monde nouveau issu de la Première Guerre mondiale. Le sont au contraire d’abondance la Turquie, l’Inde, l’Égypte… Il fut en somme plus tiers-mondiste que communiste. Et le vocabulaire (« serfs », « féodaux », « oligarchie », « ravageurs »…) renvoie davantage à un populisme révolutionnaire anarchiste qu’au marxisme-léninisme. Il parvint vaille que vaille à faire paraître Le Trait d’Union jusqu’en 1928, se débattant dans les difficultés financières, et en dépit de la collaboration de Ferhat Abbas. Il est un temps inquiété, et même, en 1925, emprisonné à la prison de Barberousse pour ses positions politiquement iconoclastes. Il doit continuer pour vivre, et pour faire vivre son journal et sa maison d’édition, à faire le représentant de commerce. Il collabore aux journaux socialistes Demain et Alger socialiste. Les petites brochures qu’il fait imprimer à compte d’auteur pour s’y exprimer en toute liberté sont mal diffusées et se vendent mal. La Ligue des Droits de l’Homme, qui tient congrès à Alger en 1930, fait sienne sa proposition de conférer les droits politiques aux Algériens. Il tente de donner au Trait d’Union un successeur sous le titre de La Tribune indigène algérienne, mais il ne parvient pas au total à publier plus de vingt numéros. Les notables algérois sur le concours financier desquels il avait cru pouvoir compter s’étaient dérobés.
Au surplus, s’il piétine, c’est peut-être aussi que ses perspectives politiques manquent de netteté. Certes son projet politique n’est pas la colonie du système colonial ; mais son tempérament est plus celui d’un dénonciateur que d’un politique au sens constructif du terme. Anticolonialiste, certes, Spielmann le fut, même s’il ne fut pas résolument un indépendantiste – rappelons qu’un grand nom comme Ferhat Abbas, en ce temps, ne l’était pas davantage. À mesure qu’en Algérie, partis et organisations politiques se structurent, Spielmann apparaît de plus en plus isolé, et comme hors du temps. S’il émeut, il ne met pas en branle de mouvement politique construit et organisé. Et, s’il parle juste, tel Cassandre, il n’est guère écouté.
Il salue en 1936 le Front populaire et le Congrès musulman, mais il ne semble pas y avoir pris une grande part. Il a, il est vrai, 70 ans ; il est usé par une vie de combats. S’est-il attelé à la rédaction de ses mémoires, annoncés dès 1934 sous le titre Un demi-siècle de vie algérienne (1877-1934) ? Nul ne sait s’il y travailla vraiment dans le contexte désespérant de l’échec du Front populaire, du projet Viollette, et du Congrès musulman. L’ouvrage, en tout cas, ne parut jamais. À sa mort en 1938, selon certaines sources, Ferhat Abbas aurait été le légataire de ses archives, de sa bibliothèque, de ses luttes passées. Sa petite maison de Frais Vallon était, il est vrai, une prodigieuse bibliothèque sur l’Algérie, sa cave regorgeait des archives qu’il avait accumulées un demi-siècle durant. Il fut salué, dans une notice nécrologique émouvante dans son Shihāb par le dirigeant des ‘ulamā’, shaykh Abdelḥamid Ibn Bādis, comme« l’ange gardien du peuple algérien » (malāk ḥāris al-sha‘b al-jazā’iriyy). Début 1954, La République algérienne de Ferhat Abbas rendit hommage à « un des tous premiers combattants pour la reconnaissance de la personnalité algérienne », « le précurseur méconnu du Manifeste du Peuple algérien », lequel avait d’ailleurs repris nombre de thèmes chers à Spielmann.
Au total, la figure d’un Victor Spielmann indique que le colonialisme fut bien, comme l’écrivit Jean-Paul Sartre, un système. S’il eut pour effet d’ériger une barrière de discrimination et de racisme entre humains – algériens colonisés et créoles colonisateurs –, existèrent aussi, des deux côtés, des humains pour vouloir abattre la barrière et appeler de leurs vœux un avenir conjoint de fraternité : le contentieux produit par le colonialisme ne fut pas, au fond, un conflit franco-algérien, même s’il put revêtir cet aspect simplifié. Ceci dit, les logiques à l’œuvre dans l’histoire ont finalement abouti à ce qui est advenu et que nous connaissons. L’historien doit aussi honnêtement évoquer tous ces hors normes, tous ces atypiques, toutes ces forces qui tentèrent de donner une juste solution politique à ce qui allait déboucher sur une des plus douloureuses guerres de libération anticoloniale ; ne serait-ce que pour faire connaître ce que fut, dans l’histoire de l’Algérie colonisée, toute la palette polychrome du divers historique, lequel ne se réduit jamais à ces binômes tranchés, gros de trop de ces simplismes qui, pour repaître d’abondance tant de pouvoirs et de mémoriels affrontés, devraient viscéralement répugner à la déontologie du territoire de l’historien.
Lire la 1ère partie : Histoire & anecdotes du passé des communistes à Bordj.
Voir à sa SOURCE : https://www.cairn.info/revue-raison-presente-2017-3-page-65.htm